Comment protéger son concubin en cas de décès ?
Vivre en union libre, sans PACS ni mariage, c’est faire le choix de la liberté et de la spontanéité, sans cadre administratif ni engagement juridique. Mais cette liberté peut devenir une source de vulnérabilité extrême lorsqu’un événement grave survient, notamment un décès. Contrairement au mariage ou au PACS, le concubinage ne confère aucun droit automatique au survivant.
Cela signifie que même après plusieurs années de vie commune, si aucune démarche n’a été entreprise, le concubin survivant peut se retrouver sans logement, sans patrimoine, et sans possibilité d’agir sur la succession.
Ce sujet, encore trop souvent négligé, soulève pourtant des enjeux humains et patrimoniaux majeurs. L’émotion liée au deuil ne doit pas être aggravée par des incertitudes juridiques ou des conflits familiaux.
Pourquoi le concubinage est-il si peu protecteur en cas de décès ?
Le droit français ne reconnaît aucun statut successoral aux concubins. En clair, le partenaire survivant n’a aucun droit sur la succession de l’autre, sauf si celui-ci a expressément prévu quelque chose de son vivant. Cela peut sembler brutal, mais c’est la réalité juridique : même après vingt ans de vie commune, si aucune disposition n’a été prise, le concubin est considéré comme un tiers.
Le concubin survivant ne peut donc ni hériter des biens du défunt, ni rester dans le logement en toute sécurité, ni prétendre à une pension de réversion. C’est la famille du défunt (enfants, parents ou frères et sœurs) qui hérite, et peut exiger la vente du logement, la récupération des meubles ou la fin de l’occupation des lieux. Cette situation est d’autant plus dramatique lorsqu’aucun enfant n’est commun au couple, ce qui renforce l’exclusion du concubin survivant.
Il est donc essentiel d’anticiper, car le simple fait de vivre ensemble ne crée aucun droit. Sans action volontaire et formalisée, le partenaire n’aura ni sécurité ni reconnaissance après le décès.
Le mariage et le PACS : des protections différentes
Le mariage, protection maximale
Le mariage est aujourd’hui le seul cadre juridique offrant une protection complète et automatique au conjoint survivant. Dès lors qu’un couple est marié, le survivant est considéré comme héritier, même en l’absence de testament. Il bénéficie d’un droit viager sur le logement familial, ce qui lui permet de continuer à l’occuper, et peut recevoir une partie du patrimoine en pleine propriété ou en usufruit, selon la situation familiale (notamment la présence ou non d’enfants).
Autre avantage considérable : le conjoint marié est totalement exonéré de droits de succession, quelle que soit la valeur de la part reçue. Le mariage reste donc l’option la plus protectrice d’un point de vue successoral, fiscal et pratique.
Le PACS n’est que la moitié du chemin réalisé pour pouvoir pleinement protéger son partenaire.
La donation entre époux (donation au dernier vivant) : un renfort de protection
Bien que le mariage offre déjà une solide protection juridique au conjoint survivant, il est possible de renforcer encore davantage ses droits grâce à la donation entre époux, aussi appelée donation au dernier vivant (DDV). Il s’agit d’un acte notarié par lequel chaque époux donne à l’autre des droits élargis sur son patrimoine, applicables uniquement en cas de décès.
Concrètement, cette donation permet au conjoint survivant de choisir entre plusieurs options au moment de la succession : l’usufruit de la totalité des biens, la pleine propriété d’une part (par exemple un quart en présence d’enfants communs) et le reste en usufruit, ou bien de prendre la totalité de la quotité disponible.
L’intérêt majeur de cette donation réside dans sa souplesse. Elle permet au survivant d’arbitrer selon sa situation au moment du décès, sans être enfermé dans une règle automatique. Elle est d’autant plus précieuse lorsqu’il y a des enfants d’un premier lit, ou un patrimoine complexe à gérer.
Autre avantage : la donation entre époux est exonérée de droits de mutation, puisqu’elle intervient entre conjoints mariés. Elle n’entraîne aucun coût fiscal supplémentaire à l’ouverture de la succession.
Le PACS, une solution intermédiaire
Le PACS est un compromis intéressant pour les couples qui souhaitent officialiser leur relation sans se marier. Il offre une meilleure sécurité que le concubinage, notamment en matière fiscale, puisque le partenaire pacsé est, lui aussi, exonéré de droits de succession. En revanche, le PACS ne confère aucun droit successoral automatique. Le partenaire survivant ne recevra rien, sauf si un testament a été rédigé pour l’avantager.
Par ailleurs, le PACS ne garantit pas de droit viager sur le logement, à moins qu’un aménagement juridique spécifique ait été prévu. Il reste donc une solution intermédiaire, qui nécessite un encadrement pour être pleinement efficace.
Le testament : un outil indispensable pour les concubins
En l’absence de mariage ou de PACS, le testament est l’unique moyen de transmettre volontairement une partie de son patrimoine à son concubin. Ce document permet de désigner librement votre partenaire comme légataire. Toutefois, cette liberté n’est pas totale. Si vous avez des enfants, une partie de votre patrimoine leur est réservée par la loi : c’est la « réserve héréditaire ». Vous ne pouvez donc léguer à votre concubin que la part restante, appelée « quotité disponible ».
Il existe plusieurs types de testaments : olographe (écrit à la main), authentique (devant notaire), etc. Quelle que soit sa forme, il doit être clair, précis et à jour. Il faut également noter que le concubin est soumis à une fiscalité lourde : 60 % de droits de succession sur la part reçue.
Pour toutes ces raisons, le testament seul ne suffit souvent pas à assurer une réelle protection financière. Il est utile, mais doit être combiné à d’autres outils.
L’assurance-vie : la meilleure solution pour transmettre sans fiscalité
L’assurance-vie permet de désigner librement le bénéficiaire de votre choix et de lui transmettre un capital en dehors du cadre de la succession légale.
Pour les sommes versées avant 70 ans, le concubin peut recevoir jusqu’à 152 500 € sans droits de succession.
Chaque bénéficiaire bénéficie de cet abattement. Le surplus est fiscalisé à 20 %, ou 31,25 % dans les plus grosses transmissions. De plus, les fonds transmis via l’assurance-vie ne sont pas soumis à la réserve héréditaire.
Attention : l’efficacité dépend de la rédaction précise de la clause bénéficiaire. Une formulation maladroite peut créer des contestations. Une rédaction rigoureuse est indispensable.
Quels montages pour protéger son concubin au-delà de l’assurance-vie ?
Lorsque le couple possède un bien immobilier ou un patrimoine important, d’autres dispositifs peuvent être envisagés. La donation entre concubins est possible, mais la fiscalité est dissuasive (60 %). Elle peut toutefois être pertinente dans une stratégie globale.
Le mandat de protection future permet également d’anticiper une éventuelle incapacité en désignant son concubin comme personne de confiance.
Si vous souhaitez protéger votre partenaire de vie au maximum, n’hésitez pas à consulter un gestionnaire de patrimoine à Toulouse pour vous accompagner dans vos démarches.

Nicolas Combes
Fondateur de Garonne Patrimoine
Nicolas a décidé de fonder une entreprise de gestion de patrimoine à Toulouse pour accompagner les particuliers dans la gestion et l’optimisation de leurs investissements.
Son expertise repose sur deux masters, dont celui de l’AUREP, référence nationale en gestion de patrimoine. Fort d’une solide expérience internationale, acquise notamment au sein de cabinets prestigieux comme PricewaterhouseCoopers, Nicolas a également exercé dans la gestion de fortune, où il supervisait plusieurs centaines de millions d’euros d’encours.
Cette expérience lui permet aujourd’hui de proposer un accompagnement sur mesure, alliant rigueur institutionnelle et proximité humaine.
Nicolas et son équipe seront ravis de vous accueillir dans leurs bureaux à Toulouse, avec une magnifique vue sur les Pyrénées.
Articles similaires
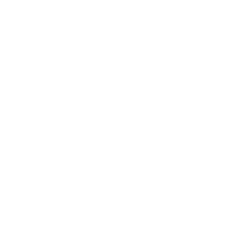
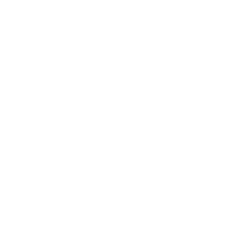
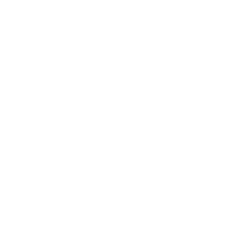
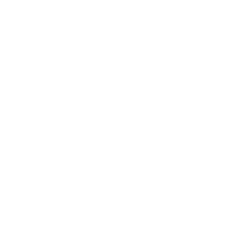
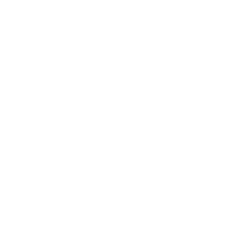
Une question ? Vous avez besoin de conseils ou d'accompagnement pour vos futurs investissements sur l'agglomération toulousaine ?
L’investissement responsable est un sujet de plus en plus présent allant même jusqu’à faire évoluer la réglementation en gestion de patrimoine. Nous revenons aujourd’hui sur les stratégies d’investissements responsables possibles à Toulouse.