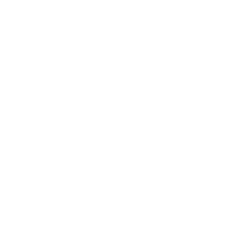Introduction générale
La création ou la transformation d’une entreprise repose, entre autres, sur la constitution du capital social, condition essentielle à toute société. Ce capital est constitué des apports réalisés par les associés ou actionnaires, qui déterminent leur part de détention, leurs droits de vote ou leurs bénéfices.
On distingue traditionnellement trois formes d’apports :
- Apport en numéraire – correspond à une somme d’argent.
- Apport en nature – porte sur un bien, qu’il soit matériel ou immatériel.
- Apport en industrie – consiste en une contribution non financière, comme des compétences ou des services.
Ces apports ont des implications juridiques, comptables, fiscales et pratiques différentes, selon la forme juridique de la société (SARL, SAS, SA, SNC…). L’article détaille chacun de ces apports en profondeur.
1. Apport en numéraire
Définition et mécanisme
L’apport en numéraire consiste en une somme d’argent versée par un ou plusieurs associés au profit de la société. Il s’agit du mode d’apport le plus simple et le plus fréquent, surtout lors de la constitution d’une entreprise.
Le dépôt des fonds peut être effectué sur :
- un compte bancaire ouvert au nom de la société en formation,
- chez un notaire,
- ou auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
Libération des apports
La libération — c’est-à-dire le paiement effectif — peut être partielle à la constitution selon la structure juridique, le reste étant libéré dans un délai fixé par la loi :
- SAS / SA : au minimum 50 % doit être libéré à la création, le solde dans un délai de 5 ans.
- SARL / EURL : au moins 20 % doit être libéré à la création, et le reste sous 5 ans.
- Autres formes (SC, SNC…) : librement fixé par les statuts, sauf dispositions spécifiques.
Implications pratiques
Le capital en numéraire contribue au fonds de roulement et à la crédibilité financière de la société. Tant que la société n’est pas immatriculée, les fonds sont bloqués.
Si l’immatriculation tarde (au-delà de 6 mois après dépôt), les associés peuvent demander le remboursement de leurs apports. C’est un apport clair, facilement valorisable et incontestable.
2. Apport en nature
Définition
L’apport en nature désigne la contribution de biens – mobiliers, immobiliers ou immatériels (brevets, marques, fonds de commerce, matériel, clientèle, etc.). Ces biens deviennent partie intégrante du patrimoine de la société.
Évaluation et obligations réglementaires
Selon le Code du commerce (article L.223 9 notamment), la valeur de chaque apport en nature doit être évaluée. Un commissaire aux apports — expert-comptable ou tiers habilité — peut être obligatoire, sauf exceptions :
- Chaque apport < 30 000 € ;
- Total des apports en nature ≤ 50 % du capital social.
Sans commissaire, les associés sont solidaires de la valeur attribuée pendant 5 ans, afin de protéger les tiers en cas de surévaluation.
Libération des apports en nature
Contrairement aux apports en numéraire, ceux en nature doivent être libérés immédiatement lors de la constitution de la société. Ils doivent être mentionnés dans les statuts ou dans un contrat d’apport annexe.
Garanties de l’apporteur
L’apporteur garantit généralement contre les vices cachés ou l’éviction (apport de marque, de clientèle, etc.). Il s’agit d’assurer la sécurité juridique et économique de la société bénéficiaire.
3. Apport en industrie
Définition et spécificités
L’apport en industrie renvoie à une contribution non financière sous la forme de :
- savoir-faire,
- compétences techniques,
- influence ou notoriété,
- travail, services.
Il s’agit d’une forme plus rare et moins simple à valoriser.
Capital social et parts sociales
Contrairement aux apports en numéraire ou en nature, l’apport en industrie n’entre pas dans le capital social. Toutefois, l’apporteur peut recevoir des parts sociales ou actions spéciales, déterminées par les statuts : droits aux bénéfices, participation aux décisions.
Restrictions juridiques
- Interdit dans les SA : pour protéger les créanciers, la loi exclut les apports en industrie des SA.
- Autorisé dans : SARL, SAS, SNC, sociétés civiles, etc.
Modalités particulières
Les parts reçues en contrepartie sont souvent non cessibles, incessibles, intransmissibles. Leur transfert, notamment en cas de décès, entraine souvent l’extinction de l’apport en industrie.
Le contrat ou les statuts doivent bien préciser :
- la nature précise de l’apport ;
- les droits attachés aux parts sociales ;
- les obligations de l’apporteur (exclusivité, durée…).
Risques et précautions
Il faut veiller à éviter une requalification en contrat de travail : l’apporteur doit garder son statut d’associé, sans lien de subordination.
Tableau comparatif
| Apport | Entrée dans le capital social | Libération / Valorisation | Besoin de commissaire ? | Principaux avantages / limites |
|---|---|---|---|---|
| Numéraire | Oui | Partielle ou totale (selon statut) | Non | Liquidité, simplicité, crédibilité financière |
| Nature | Oui | Immédiate, bien évalué | Oui (selon seuils) | Permet d’apporter des biens utiles, mais évaluation complexe |
| Industrie | Non | Non monétaire, défini précisément | Non (mais statuts indispensables) | Valorise des compétences, mais parts souvent intransmissibles |
Pour conclure
La diversité des apports en société offre une flexibilité précieuse pour fonder ou faire évoluer une entreprise :
- Apport en numéraire : simple, liquide, indispensable pour le financement initial.
- Apport en nature : permet d’apporter des biens utiles à la société, mais impose rigueur et évaluation.
- Apport en industrie : valorise les compétences et le savoir-faire de l’associé, sans faire augmenter le capital, mais nécessite une rédaction minutieuse des statuts.
Ces apports jouent un rôle central dans l’équilibre juridique, financier et opérationnel d’une société. Leur combinaison (par exemple numéraire + nature, ou numéraire + industrie) permet de couvrir divers besoins tout en répartissant les droits de manière équitable.
Si vous avez besoin de conseils, contacter un gestionnaire de patrimoine à Toulouse.